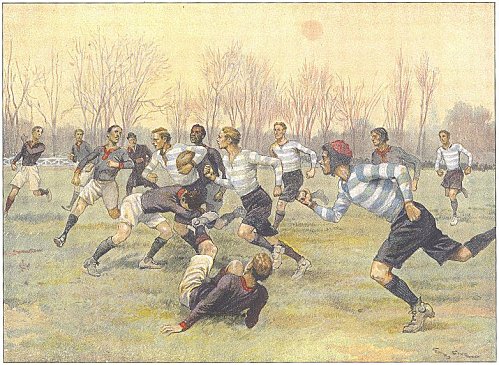|
- Max Guazzini ou la résurrection d'un mythe
|
|
L'identité du rugby colle-t-elle toujours au maillot
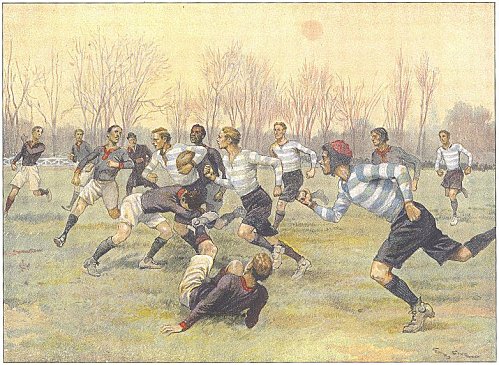
|
|
Gravure représentant la
première finale du championnat de France en 1892 entre le Racing Club
de France et le Stade Français. Le Racing arborrait déjà son mythique
maillot ciel et blanc, le Stade portait son bleu et rouge originel.
|
On ne regarde plus le rugby aujourd’hui comme il y a encore dix ans.
Maillots aux couleurs flashy, vêtements sportswear, calendriers sexy…
L’image du rugby a fondamentalement changé. Mais n’est-il pas allé trop
loin dans cette logique marketing ? S'il continue à chercher à toucher
le plus grand nombre à n'importe quel prix, le rugby risque de se
couper de son public originel et des fameuses "valeurs" qui rendent ce
sport si unique..
Le rugby, sport empreint de traditionalisme, où il fallait encore «
défendre le cloché » il n’y a pas si longtemps, connaît une véritable
révolution. Comme l’a dit Pierre Camou « être rugby est devenu Tendance
». Débarrassé de son image vieillotte, le rugby s'ouvre à de nouveaux
publics, notamment les jeunes et les femmes. Des populations vers qui
les clubs dirigent de plus en plus leurs attentions, à coups de
stratégies marketing bien ciblées : places à prix réduits (à partir de
5 ou 10 euros) et même gratuites, ce qui permet d’aller au stade en
famille, des places offertes aux femmes. Autant de « petits cadeaux »
qui permettent de fidéliser ces nouveaux adeptes. Le précurseur en ce
domaine s’appelle Max Guazzini. Le président du Stade Français avait
débuté dès 1996, avec la gratuité pour les matches à domicile. Il a
ainsi réalisé de meilleures affluences que des clubs de l’Elite, alors
que le Stade Français était encore en 2e division. Les autres clubs,
après avoir protesté, s’y sont mis. Dernier exemple en date, le Castres
Olympique qui invite ses supportrices au matche samedi 6 mars, pour la
journée de la femme.
Maillots : la 1e vitrine d’une équipe
Pour autant ces opérations de promotions ne gardent qu’un effet limité
au temps où elles sont en place, si les nouveaux spectateurs ne se
reconnaissent pas dans l’image du rugby en général, du club en
particulier. Les clubs, là aussi à l’initiative du Stade Français, ont
peu à peu adapté leur image. A commencer par les maillots. Première
vitrine d'un club, ils se sont peu à peu transformés, et ont abandonné
certains des signes distinctifs des vêtement de rugby, comme les
rayures. Une évolution avant tout permise per l’évolution des matières.
En abandonnant les maillots en coton, les équipementiers ont permis de
faire évoluer les motifs. Le Stade Français en a profité dès la saison
1997-1998 avec la montée en 1e division (A1). Son maillot bleu s’est
paré d’éclairs rouges, au détriment des traditionnelles rayures. Vu par
certains comme un hommage à Flash Gordon en raison des trois montées
successives en 1995, 1996 (à la faveur de la fusion avec le CASG) et
1997. Le maillot était ainsi tout de suite identifiable et a permis aux
produits (vêtements, affiches, autocollants…) frappés d’éclairs rouges
d’être tout de suite associés au club. Pour autant le Stade Français
gardait ses couleurs traditionnelles depuis la création du club en 1883
: le rouge de la ville de Paris et le bleu marine de l’université
d’Oxford, en opposition avec le Racing Club de France qui avait choisi
le bleu ciel de Cambridge en 1882. Le maillot conservait aussi des
signes propres au rugby avec un « vrai » col. Par la suite les
teintes vont évoluer, la taille, la position et le nombre des éclairs
aussi : Adidas les réduira à trois, pour rappeler sa propre identité
avec une référence aux « trois bandes » de son logo. Les trois éclairs
sont d’ailleurs devenus l’emblème du Stade Français, même lorsqu’il
changera d’équipementier en signant avec Kappa pendant deux saisons
(2002-2004).
Le Stade Toulousain, qui à l’inverse du Stade Français
possédait une forte implantation dans sa ville et d’une forte
popularité, a aussi fait évoluer ses maillots. Les rayures ont
largement diminuées en taille et en nombre dans les années 1990, avant
de disparaître dans le années 2000, en même temps que le col des
maillots. Cette évolution s’est généralisée à tous les clubs
professionnels. Même sur les terrains amateurs, les maillots moulants
se sont généralisés et il est de plus en plus rare de croiser des
rayures. Seul le Racing Club de France, devenu Rancing-Métro, conserve
aujourd’hui ses rayures originelles (dont les couleurs et la taille
sont brevetées), éternellement bleues ciel et blanches. Ce qui fait
dire à Gilles Balsan, président de Génération Yves du Manoir, un groupe
de supporters du Racing-métro : « le Racing est le seul club qui
conserve un vrai maillot de rugby ». A ses yeux, même les maillots de
clubs comme Toulouse et Clermont, qui conservent toujours les mêmes
couleurs mais qui jouent sur le design, relèvent d’un « marketing
ridicule ».
Tenues roses
Mais la grande révolution dans le design des maillots se situe
incontestablement en 2005, avec l’apparition du 1er maillot rose du
Stade Français. Ce fut un grand choc pour le monde du rugby. A
commencer pour les joueurs du Stade Français, qui refusèrent dans un
premier temps de le porter lorsqu’ils leur furent distribués avant un
match à Perpignan, en septembre 2005. Malgré une fronde dans les
vestiaires, ils finirent par céder à leur président, toujours Max
Guazzini. Les réactions du reste du rugby professionnels furent vives à
l’égard de ce maillot tant sa couleur fortement connotée « Gay friendly
» semblait en contradiction avec l’image virile et traditionnelle des
rugbymens. Néanmoins le succès populaire fut incontestable : 20 000
exemplaires de a 1e édition du maillot rose furent fabriqués par
Adidas. Un beau succès pour ce qui n’était encore qu’un maillot pour
les matches à l’extérieur. S’il reste aujourd’hui la seconde livrée, il
est désormais ancré dans l’identité du club. Un maillot rose = Stade
Français. En 2008, ce sont même 92 000 exemplaires qui se sont vendus.
Franck Lemann, président fondateur du groupe de supporteurs du Virage
des Dieux en 2004, assume complètement cette couleur : « Avec les trois
éclairs, le rose est le 1er signe distinctif du Stade Français. Nous
avons encouragé nos membres à tous venir en rose et nous sommes
désormais très identifiables dans les stades même à quelques uns ». Une
appartenance affichée jusque sur leur site internet, entièrement paré
de rose.
Malgré les protestations premières, le maillot rose et
son succès a permis de décomplexer les autres clubs. Des maillots plus
« tendance » avec des couleurs plus originales se sont répandues. Les
clubs ont appuyés sur différents leviers pour tenter d’accéder à la
réussite populaire du Stade Français. Les deux clubs basques, Bayonne
et Biarritz, ont fait appel à l’identité régionale et paré leurs
maillots pour la coupe d’Europe du drapeau basque. Montauban a choisi
un vert fluo pour son maillot 2008-2009. Toulon a lui réalisé un
maillot rappelant celui du 1er titre de champion de France (1931). Même
Toulouse a dérogé à ses sacro-saintes couleurs rouge et noir à
l’occasion de son centenaire en 2007. Cette expérience qui
devrait rester unique a donné un maillot légèrement rosé, en hommage à
la « ville rose ». Le pale du rose, contrastant avec celui du Stade
Français, a fait dire à Max Guazzini qu’il ressemblait plus à maillot
blanc sur lequel aurait déteint un vêtement rose, qu’à un véritable
maillot rose.
Surenchère
Max Guazzini a du néanmoins se sentir menacé par cette généralisation.
Le président du Stade Français semble désormais enclin à la surenchère.
En 2006-2007 apparaît le 1er maillot à fleurs de lys rose, dont la
conception fut réalisée par l’entreprise de mode Kenzo. Une nouvelle
originalité plutôt bien reçue, surtout pour le troisième maillot
destiné à la coupe d’Europe où les clubs et les équipementiers peuvent
se permettre plus de libertés. Mais dès la saison suivante, un maillot
dérivé, affublé de bandes argentées, sonne le glas du rouge originel
sur le maillot. Guazzini ne s’arrête pas là. Des fleurs de lys
stylisées, l’image de Blanche de Castille (une image de la Vierge étant
envisagée à l’origine) avec un graphisme à la Warhol, et des motifs «
manga » sont successivement apparus. Malgré le rappel au blason de la
ville de Paris ou aux étudiants du lycée Saint-Louis qui ont fondé le
Stade Français (Blanche de Castille est la mère de Saint-Louis), ces
maillot semble plus issus d’une démarche purement commerciale que de la
volonté originelle de renouveler l’image du rugby.
L’enjeu est de taille. Une étude du cabinet NPD Group a
établi le marché du rugby à 20 millions d’euros en 2006, dont 13
millions pour les seuls maillots. Avec la Coupe du Monde 2007, ces
chiffres ont explosé. La guerre des équipementiers déjà très présente
dans le foot, s’est exportée dans le monde du rugby. Adidas, qui a
perdu l’équipe de France au profit de Nike, possède son principal atout
avec les All Blacks. L’équipe néozélandaise est l’une des seules à
vendre des maillots partout dans le monde. A l’approche de la
compétition, la marque aux « trois bandes » avait écoulé 460 000
maillots des Blacks dont 70 000 en France. Nike a contre-attaqué avec
une grosse communication autour des bleus et près de 500 000 maillots
vendus. La marque américaine équipe également l’équipe d’Angleterre,
finaliste de l’épreuve. Un avantage de taille quand on sait que la
Grande-Bretagne truste 60 % des ventes de maillots dans le monde. Les
équipementiers ont aussi tenté de se distinguer par le design des
maillots. Adidas n’a pas eu grand chose à faire en s’appuyant sur des
valeurs sures. Les All Blacks ont ainsi conservé leur maillot
entièrement noir. De même les Pumas argentins ont affichés leurs
rayures ciel et blanches. Nike a par contre innové avec une « vague »
en travers des maillots français et anglais. Le maillot français a
également abandonné son bleu traditionnel pour un bleu nuit. Mais les
deux géants se sont finalement fait voler la vedette par Canterbury of
New Zealand. Spécialisé dans le rugby, l’équipementier a obtenu juste
avant la Coupe du Monde 2007 des contrats avec les équipes du Japon,
d’Ecosse, d’Irlande, d’Australie et d’Afrique du Sud, qui deviendra
championne du monde. Canterbury proposait notamment un design simple,
mais tout de suite identifiable à la marque, pareils sur tous les
maillots. Il s’est également imposé comme le premier équipementier du
Top 14 (championnat de France de 1e division) avec Perpignan (champion
de France 2009), Clermont (finaliste 2009), Dax, Bayonne et Castres.
Canterbury a continué la même logique de modèle unique, le modifiant
que très peu les années suivantes. Il s’est néanmoins exposé à la
critique de certains supporters, qui en dépit de la réussite du
maillot, regrettaient l’amalgame créé entre les différentes équipes. La
situation changera d’ailleurs radicalement lors de la saison 2010-2011,
Canterbury ayant été racheté et se retirant du rugby européen. Autant
dire que les autres équipementiers ont lancé la chasse pour récupérer
les clubs.
Rejets
Pour autant, clubs et équipementiers ne peuvent pas faire n’importe
quoi sur leurs maillots. Mis à part le Stade Français, beaucoup de
clubs ont déposé leurs couleurs. Elles restent aux yeux de beaucoup le
premier critère d’identification d’un club. Thierry Fraisse, président
de l’Interclubs Les Jaunes et Bleus réunis, regroupant des associations
de supporters de l’ASM Clermont Auvergne, rappelait ainsi l’arrivée de
Canterbury comme équipementier de Clermont en 2007. Apparemment pris de
cours, la marque ne pouvait pas fournir des maillots avec les jaune et
bleu traditionnels pour des raisons techniques. « Les gens ne se
sont pas reconnus. Les critiques se sont faîtes entendre sur les forums
». On reste très loin des supporters du PSG qui ont manifesté au début
de la saison 2009-2010 contre le bleu marine très éloigné du bleu
originel du club, mais le retour aux « vraies couleurs » la saison
suivante a été accueillie avec soulagement. De même certains supporters
du Stade Français expriment leurs oppositions à l’abandon du rouge et
du bleu. Certains vont même jusqu’à lui imputer les mauvais résultats
de la saison 2008-2009 et 2009-2010. Loin de ce postulat, Franck Lemann
reconnaît néanmoins que « la multiplication des maillots complique
l’identification ». Si pour lui le rose fait désormais partie de
l’identité du club, plus que le bleu et rouge moins identifiables, il
avoue ne pas être convaincu par le maillot « tatoo », 3e tenu du club
en 2009-2010. L’absence de couleur dominante et la multiplicité des
motifs ne représentent pas l’image du club. D’ailleurs beaucoup
d’amateurs de rugby franciliens se sont vite retournés vers le
Racing-Métro lors de son accession en Top 14 à l’issue de la saison
2008-2009. Des « anciens » qui considèrent que le Racing est le club
historique en Ile de France, mais aussi des jeunes. Effet Chabal
(arrivé au club avec la montée) faisant, de nombreux adolescents se
sont parés du maillot ciel et blanc. Certaines rumeurs disent aussi que
le 2e maillot du Racing-Métro rouge et bleu (couleurs du Métro) a été
choisi dans ces tons pour séduire des supporters du Stade Français
désorientés par la politique marketing de Guazzini.
Le retour semble d’ailleurs à un retour à plus de
modération. A l’image du Racing-Métro qui base l’essentiel de son
marketing sur son image historique (1er champion de France en 1892
contre le Stade Français, rayures, stade olympique de Colombes…),
nombre d’équipes semblent revenir vers des tenues plus classiques. Nike
a abandonné la « vague » sur ses maillots (France, Angleterre,
Toulouse) pour un design plus sobre. Le maillot anglais est redevenu
entièrement blanc (à part un liseré rouge au col), la France est revenu
un maillot quasiment uni mais reste très sombre. Montauban a abandonné
le fluo pour un vert moins voyant et des rayures reviennent sur le
maillot. Enfin d’aucun au Stade Français ne serait pas contre un
maillot rétro avec des rayures rouges et bleues.
Le Fléo
|











 Carlos Ghosn, patron de Renault, promet que la berline électrique ne coûtera pas plus chère que l'essence. Peut-on le croire ?
Carlos Ghosn, patron de Renault, promet que la berline électrique ne coûtera pas plus chère que l'essence. Peut-on le croire ? Autonomie, coût, pollution, puissance: un point de situation sur les avantages et les limites des véhicules écolos
Autonomie, coût, pollution, puissance: un point de situation sur les avantages et les limites des véhicules écolos